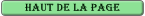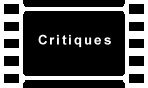- Accueil
- Classement
- Critiques par titre
- Critiques par date
- Notules
- Br1èves et spoilers
- Meilleurs et pires
- Dédaignés
- Recherches
- Vite !
- Téléciné
L’année 2017 commence lentement, avec un gros succès international, La La land, un peu surfait, un film bien meilleur, Un jour dans la vie de Billy Lynn, un grand film danois, Les oubliés , et un Entracte 27 consacré à Jerry Lewis.
La La land
Réalisateur : Damien Chazelle
Scénario : Damien Chazelle
Interprètes : Ryan Gosling (Sebastian), Emma Stone (Mia), Amiée Conn (actrice célèbre), Terry Walters (Linda, directrice du Coffee Shop), Thom Shelton (coffee spiller), Cinda Adams (directrice de la première audition), Callie Hernandez (Tracy), Jessica Rothe (Alexis), Sonoya Mizuno (Caitlin), Rosemarie DeWitt (Laura), J.K. Simmons (Bill), Claudine Claudio (Karen, serveuse), Jason Fuchs (Carlo), D.A. Wallach (chanteur des années 80), Trevor Lissauer (valet), Olivia Hamilton (Bree, a fille qui ne veut pas de gluten), Anna Chazelle (Sarah, assistant l’adjoint de l’audition), Marius De Vries (directeur du pilote), Finn Wittrock (Greg), Josh Pence (Josh), Nicole Coulon (la fiancée de Josh), Damon Gupton (Harry), John Legend (Keith), Christopher Michael Stevens (Malcolm), Keith Harris (Cole), Kaveh Rastegar (Tom), Shaylah J. Stevens (chanteur Echo Backup), Natalie Imani et Briana Lee (chanteuses Echo Backup), David Douglas (passeur de disque à la radio), Miles Anderson (Alistair, photographe), Bobo Chang (assistant du photographe), Meagen Fay (mère de Mia), Robert Haynes (voisin colérique), John Hindman (Frank, réalisateur), Valarie Rae Miller (Amy Brandt), Nicole Wolf (assistante d’Amy Brandt), Corrin Evans (nouveau préparateur de café), Kiff VandenHeuvel (nouveau directeur du Coffee Shop), Tom Everett Scott (David), Camryn Ray Cavaliero (sÅ“ur de Mia), Zoë Hall (Chelsea), Dempsey Pappion (employé du Seb’s Jazz Club), Eddie Clifton (batteur du Seb’s), Cal Bennett (saxophoniste du Seb’s), Nedra Wheeler (bassiste du Seb’s), Javier Gonzalez (trompettiste du Seb’s), Khirye Tyler (pianiste du Seb’s), Arthur Horowitz (Fantasy Baby), Jillian Meyers et Michael Riccio (assistants chorégraphes), Reshma Gajjar (danseuse n° 1 sur l’autoroute), Hunter Hamilton (danseur n° 1 sur l’autoroute), Damian Gomez (danseur n° 2 sur l’autoroute), Candice Coke (danseuse n° 2 sur l’autoroute), Amanda Balen (danseuse sur l’autoroute et conductrice), Mecca Vazie Andrews, Lou Becker, Doran Butler, Matt Cady, Dominic Chaiduang, Cindera Che, Carol Connors, Patrick Cook, Aaron Cooke, Tiffany Daniels, Bubba Dean Rambo, Nick Drago, Shaun Evaristo, Dana Fukagawa, Daniel Gaymon, Liz Imperio, Casey Johansen, Cristan Judd, Yoori Kim, Marissa Labog , Stephanie Landwehr, Chris Moss, Clarice Ordaz, Nathan Prevost, Bradley M. Rapier, Britt Stewart, Melinda Sullivan, Dana Wilson, Terrance Yates (danseurs et danseuses sur l’autoroute), Tracy Shibata (danseuse n° 1 à la fête d’Hollywood), Dominque Domingo (danseuse n° 2 à la fête d’Hollywood), Asiel Hardison (agent n° 1 à la fête d’Hollywood), Corey Anderson (agent n° 2 à la fête d’Hollywood), Nick Baga (agent n° 2 à la fête d’Hollywood), Scott Hislop (danseur à la fête d’Hollywwod, garçon effrayant), Leah Adler, Montana Efaw, Krystal Ellsworth, Natalie Gilmore, Sarah Mitchell, Brittany Parks(danseuses à la fête d’Hollywood), Noel Bajandas, Khasan Brailsford, Denzel Chisolm, Shannon Holtzapffel, Galen Hooks, Jeremy Hudson, Morgan Larson, George Lawrence Jr, Kc Monnie, Scott Myrick, Victor Rojas (danseurs à la fête d’Hollywood), Anthony Bellissimo, Ryan Ramirez, Bryan Tanaka (danseurs Echo), Catalina Rendic (danseuse Echo), Ava Bernstine, Gakenia Muigai, Becca Sweitzer (danseuses du restaurant), Mario Diaz, Quinn Lipton, Michael Stein (danseur du restaurant), Samantha Abrantes, Monie Adamson, McKenzie Anderson, Sybil Azur, Pamela Chu, Lexie Contursi, Mallauri Esquibel, Tara Nicole Hughes, Kayla Kalbfleisch, Megan Lawson, Martha Nichols, Eartha Robinson, Julie Schmid, Chelsea Thedinga, Emily Williams (danseuses de l’épilogue), Matthew Aylward, Demian Boergadine, Michael Higgins, Chris Jarosz, Matthew Kazmierczak, Paul Kirkland, Anthony Marciona, Michael Munday, Ryan Novak, Brandon O’Neal, Bill Prudich, Robert Roldan, Danny Valle, Gustavo Vargas (danseurs de l’épilogue)
Musique : Justin Hurwitz
Directeur de la photographie : Linus Sandgren
Montage : Tom Cross
Décors : Austin Gorg
Durée : 2 heures et 8 minutes
Sortie : en France le 25 janvier 2017
Après Whiplash, court-métrage puis long-métrage, film parfait dans son propos et sa simplicité, et qui a été conçu après La La land afin que son auteur puisse persuader les producteurs qu’il était capable de mener un projet jusqu’à son terme, Damien Chazelle tente de réaliser son rêve de comédie musicale, s’inspirant surtout de deux films de Jacques Demy, Les demoiselles de Rochefort et Les parapluies de Cherbourg, mais en beaucoup moins bien. En fait, après la brillante introduction, exploit réalisé en deux jours durant un weekend et qui affirme son talent de réalisateur, on est un peu navré de le voir gâcher son talent avec un film aussi conventionnel. Car, de comédie musicale, La La land n’offre qu’une dose homéopathique : cette séquence de l’autoroute, copieuse et très bien réalisée, au début, une autre plus courte, à la fin, et, entre les deux, quelques brèves scènes où les deux acteurs esquissent deux ou trois pas et fredonnent, pas très bien car aucun des deux n’est chanteur ou danseur. Outre cela, cette séquence chorégraphiée du début, contrairement à ce qu’on aime tant dans Les demoiselles de Rochefort, ne nous apprend pas grand-chose sur les personnages, car les deux principaux protagonistes n’échangent aucune parole, et les autres ne sont que des figurants dont on ne saura pas le nom et qui ne bornent à danser – plutôt bien, du reste. Quant à la séquence chorégraphiée de la fin, une rêverie de Mia qui imagine la vie qu’elle aurait eu si elle ne s’était pas séparée de son amoureux, si elle reprend le thème final vu dans Les parapluies de Cherbourg, son caractère mélancolique émeut assez peu, car tout cela n’a été dû qu’au désir de réussir des deux ex-amoureux, qui ont raté leur vie, chacun de son côté, après une longue séparation qu’ils n’ont pas su éviter – et ils le savent. Si bien que le récit est un peu gâché par le travers coutumier des auteurs de comédie, consistant à injecter de l’émotion dans une histoire qui pouvait fort bien s’en passer. Bref, bien loin des comédies optimistes et satiriques comme Singin’ in the rain, ou de l’élégance joyeuse des films avec Fred Astaire, ici, tout le scénario baigne dans une tristesse assez étrangère à la comédie musicale. Même les deux morts de West side story ne rendaient pas le film lugubre !
Pourtant, maintenons-le par un souci de justice, le film commence superbement, par une longue séquence de danse contemporaine, techniquement tout à fait dans le style de Demy, avec cette difficulté supplémentaire qu’elle a été filmée sur une portion d’autoroute, le Century Freeway I-105, que la police de Los Angeles avait accepté de fermer pour la circonstance, comme ce fut le cas pour le film Speed en 1995. Mais, si la chorégraphie est bonne, la musique m’a semblé un cran au-dessous, et les chansons, peu nombreuses, sont plutôt rabâchées tout au long du récit.
L’histoire est très pudique, puisqu’elle ne comporte aucune scène d’amour entre les deux personnages, qui, comme dit plus haut, ne feront pas leur vie ensemble, sinon en rêve, après que Mia eut épousé un autre homme et en a eu un enfant. La scène où elle retrouve par hasard son ex-amoureux dans le club de jazz qu’il a fondé et où elle (ou lui ?) rêve qu’ils reprennent leur histoire passée est entièrement imaginée, et ils n’échangent pas un mot.
Tout se passe à Los Angeles, comme le suggère le titre (La = L.A. = Los Angeles), où vivent et végètent Sebastian et Mia. Lui est pianiste de jazz sans succès, elle est actrice débutante et qui rate toutes ses auditions. Bien entendu, on devine dès le début qu’ils vont réussir et devenir vedettes, car c’est la règle au paradis du « rêve américain » [sic]. Aucune surprise, donc, puisque d’innombrables films ont ressassé ce thème. Et l’animosité qu’ils partagent au début va évidemment se transformer en amour, toujours selon les canons en vigueur au pays du rêve calibré, ce qui se concrétise par une scène assez nunuche, une faute de goût, filmée dans l’observatoire Griffith qui avait servi au film de Nicholas Ray Rebel without a cause (en français, La fureur de vivre, avec le navrant James Dean), avec effet spécial numérique figurant une danse dans un ciel étoilé...
C’est très nostalgique, bourré de références cinématographiques assez obsessionnelles (Casablanca, Rebel without a cause), et se conclut par un épilogue qui remet enfin au premier plan la chorégraphie qui manque tant à ce film. Bref, entre deux séquences dansées qui seules valent le dérangement, un mélo assez pesant, prévisible et ennuyeux. Je pense que Spielberg, qui avait prouvé dans 1941 et dans le prologue d’Indiana Jones and the temple of doom ses capacités dans ce domaine – où il montrait davantage d’énergie –, aurait été le mieux placé pour ressusciter le genre, qui hélas va demeurer moribond, en dépit des cris d’admiration de la critique unanime. Ne resteront par conséquent que les films du passé.
(Et puis, mon Dieu, qu’Emma Stone est peu charismatique ! La tristesse qu’elle dégage plombe le film. Si Ryan Gosling, dont on a beaucoup tenu à nous faire savoir qu’il s’était consciencieusement entraîné à jouer au piano alors qu’il n’est pas pianiste, tient plutôt bien sa partie, elle ne paraît avoir été recrutée que parce qu’elle est bankable, comme il faut dire. Je pense que c’est une erreur de distribution)
Le film a coûté trente millions de dollars, et a rapporté bien davantage. Alors que Whiplash n’avait coûté que 3,3 millions. Mais il avait rempli sa fonction.
En bref : à voir à la rigueur.
Un jour dans la vie de Billy Lynn
Réalisateur : Ang Lee
Titre original : Billy Lynn’s long halftime walk
Scénario : Jean-Christophe Castelli , d’après un livre de Ben Fountain
Interprètes : Joe Alwyn (Billy Lynn), Garrett Hedlund (Dime), Arturo Castro (Mango), Mason Lee (Foo), Astro (Lodis), Beau Knapp (Crack), Ismael Cruz Cordova (Holliday), Barney Harris (Sykes), Vin Diesel (Shroom), Steve Martin (Norm), Chris Tucker (Albert), Kristen Stewart (Kathryn), Makenzie Leigh (Faison), Ben Platt (Josh), Bruce McKinnon (le père de Billy), Deirdre Lovejoy (la mère de Billy), Laura Lundy Wheale (Patty Lynn), Allen Daniel (le major Mac), Randy Gonzalez (Hector), Tim Blake Nelson (Wayne)
Musique : Jeff Danna et Mychael Danna
Directeur de la photographie : John Toll
Montage : Tim Squyres
Décors : Gregory S. Hooper, Kim Jennings, Thomas Minton et Aziz Rafiq
Durée : 1 heure et 53 minutes
Sortie : en France le 1er février 2017
Je ne l’écris pas souvent, mais ce film mériterait bien davantage un prochain Oscar que ce pauvre La La land, qui n’est jamais qu’un mélo moyen et mollasson sur deux artistes mettant du temps à réusssir mais « que la vie va séparer » [sic] – sans quoi il n’y aurait pas de film. Ce thème a souvent été utilisé au cinéma, donc, rien d’original.
Mais l’Oscar, Billy Lynn’s long halftime walk ne l’aura pas, car Hollywood détestera qu’un cinéaste d’origine taïwanaise, quoique devenu un des grands du cinéma hollywoodien, lui rappelle que les États-Unis perdent toutes leurs guerres depuis 1945, et que leurs dirigeants, tout en proclamant leur amour de la liberté [re-sic], n’ont en tête que le souci de rendre les riches plus riches, y compris en pratiquant, comme actuellement, la xénophobie à outrance, et, au besoin, en envoyant ses jeunes au casse-pipe en leur faisant croire qu’ils combattent pour ladite liberté. Ajoutons qu’outre cela, si les États-Unis pratiquent un patriotisme à tout crin et passablement ridicule (chanter l’hymne national avec la main droite sur la clavicule, confondue avec le cœur), s’ils envoient leurs boys faire la guerre loin de la mère-patrie et leur tressent des fleurs quand ils reviennent, en réalité, ils détestent les survivants comme on déteste sa conscience quand elle vous chatouille un peu trop. Voir le tout premier Rambo !
Le Billy Lynn du titre est un jeune Texan de 19 ans, qui s’est engagé pour pouvoir payer le traitement médical de sa sÅ“ur accidentée, et a été envoyé en Irak, en 2004, au temps de Saddam Hussein. Là, au cours d’une escarmouche, il tente de ramener dans les lignes amies son sergent qui a été blessé, mais trop tard puisque le sous-officier meurt très vite. Or une caméra restée ouverte a filmé l’évènement, l’enregistrement est diffusé aux États-Unis, et l’armée ramène pour quelques jours l’escouade entière, afin d’exhiber le « héros » et ses camarades. On pense au film de Clint Eastwood sur ce petit groupe de soldats devenus célèbres, durant les combats dans le Pacifique, pour avoir simplement servi de figurants dans l’élaboration d’une photo abondamment truquée qui a ensuite servi d’instrument de propagande. Mais Eastwood dénonçait fort peu l’imposture et se contentait de raconter les faits. Ici, on prend parti. Billy, ses camarades et leur supérieur immédiat, un sergent humaniste, sont scandalisés par les exhibitions auxquelles on leur impose de participer : patriotisme, glorification de « l’Amérique » [re-re-sic, car nul ne songe que l’Amérique est un continent, dont les États-Unis ne sont qu’une petite partie, mais qui ont annexé le tout], drapeau, musique pop, feux d’artifice, discours où s’étale une vanité nationale fort peu justifiée par les faits, avec, en prime, ces brochettes de soldats au garde-à-vous sur le terrain de sport. Au point que le héros de cette histoire, humilié, en vient à souhaiter de retourner en Irak, malgré le souhait de sa sœur aînée qui suggère de l’aider, via l’intervention d’un psy, à se faire exempter.
La publicité nous révèle que le film a été réalisé avec des techniques spéciales : 120 images par seconde au lieu de 24, quadruplement du nombre de pixels des images, filmage en 3D, et ainsi de suite. Or très peu de salles sont capables de suivre cette technique (une seule dans la banlieue parisienne, à Ivry), donc tout cela n’a pas grand intérêt. En revanche, scénario, dialogue et mise en scène dépassent de loin ce qui est produit habituellement. Et on retiendra cette phrase prononcée par Billy : « On me récompense pour le pire jour de ma vie », et « En Irak, on nous tue, on se moque pas de nous ».
Le film est construit sur un montage parallèle entre les scènes de guerre et les séquences présentes, totalement décalées, où les soldats sont forcés de participer à un cirque, et comprennent que leurs compatriotes, grugés par leurs dirigeants, sont désormais coupés de la réalité et ne voient aucun mal à laisser accomplir en leur nom des horreurs qui les déshonorent.
Joe Alwyn, qui incarne Billy, est très émouvant, simplement par ses regards et quelques larmes de honte. La honte, un état d’esprit qui n’est pratiquement jamais filmé ailleurs...
En bref : à voir absolument.
Les oubliés
Titre original : Under sandet
Réalisateur : Martin Zandvliet
Scénario : Martin Zandvliet
Interprètes : Roland Møller (sergent Carl Rasmussen), Louis Hofmann (Sebastian Schumann), Joel Basman (Helmut Morbach), Mikkel Boe Følsgaard (lieutenant Ebbe Jensen), Laura Bro (Karin), Zoe Zandvliet (Elisabeth, la fille de Karin), Mads Riisom (le soldat Peter), Oskar Bökelmann (Ludwig Haffke), Emil Belton (Ernst Lessner), Oskar Belton (Werner Lessner), Leon Seidel (Wilhelm Hahn), Karl Alexander Seidel (Manfred), Maximilian Beck (August Kluger), August Carter (Rudolf Selke), Tim Bülow (Hermann Marklein), Alexander Rasch (Friedrich Schnurr), Julius Kochinke (Johann Wolff), Aaron Koszuta (Gustav Becker), Levin Henning (Albert Bewer), Michael Asmussen (sergent danois), Magnus Bruun, Nicholas Hejl, Kim Winther (soldats danois), Mette Lysdahl (infirmière Lone Nielsen), Johnny Melville (l’officier Givens), Anthony Straeger (l’officier Garth), Suri (le chien Otto), Thomas Østergaard (soldat britannique)
Musique : Sune Martin
Directeur de la photo : Camilla Hjelm
Montage : Per Sandholt et Molly Marlene Stensgaard
Décors : Set Turner
Sortie : en France le 1er mars 2017
Ce film possède trois titres : le titre français, qui ne veut rien dire et recèle même un contresens, puisque les jeunes soldats de cette histoire, loin d’être « oubliés », auraient préféré l’être ; un titre en anglais, Land of mine (en français, « La terre qui est mienne », sans grand rapport non plus avec le sujet) ; et le titre danois qui signifie « Sous le sable », et n’a que l’inconvénient d’avoir déjà servi chez François Ozon en 2000. Cette histoire évoque le film de Bernard Wicki Die Brücke (en français, Le pont), sorti en 1959, et qui racontait que, peu avant la fin de la Deuxième guerre mondiale, Hitler, à court de soldats, avait fait incorporer des lycéens, dont une classe entière d’une petite ville. Or ces très jeunes gens avaient été affectés, par un officier compatissant et conscient de leur inexpérience militaire, à la garde d’un pont qui, non stratégique, n’aurait jamais dû voir l’ennemi – les Alliés. Or, ledit ennemi attaquait la région, et les jeunes, par patriotisme et croyant bien faire, défendaient leur pont et se faisaient massacrer.
Ici, aucun ennemi, et la guerre vient de se terminer. Mais les Danois, dont les plages de leur Jutland ont été truffées par 2 200 000 mines, estiment que c’est aux Allemands de déminer toute cette surface, et y affectent des prisonniers allemands, sans tenir compte que ces jeunes gens, dont rien n’indique qu’ils ont été nazis, ne sont pour rien dans tout cela. Leit-motiv : c’est votre armée qui a posé ces mines, à vous de les enlever, et si vous sautez, on s’en fiche !
Des onze premiers recrutés, trois seront victimes de la mine qu’ils tentaient de désamorcer. On les remplace par trois autres, mais, lorsque toute la plage a été déminée et que les mines qu’on croyait désamorcées sont entassées dans un camion, l’une d’elles, restée intacte, fait sauter le véhicule et tout son contenu, et seuls quatre des jeunes échappent à la mort. Et parce que le lieutenant danois qui chapeautait toute l’opération annonce qu’ils ne seront pas libérés comme convenu et qu’on les enverra sur une autre plage à déminer, le sergent, qui les commandait parfois durement, décide de les faire évader et les conduit en secret à la frontière séparant le Danemark et de l’Allemagne.
C’est ce sergent allemand, nommé Rasmussen, qui est le personnage le plus intéressant de cette histoire : présenté au début comme une brute qui hurle et frappe parfois les jeunes qu’il doit commander, il finit par s’apitoyer sur eux, les traiter un peu comme ses enfants, et sauve la vie des derniers survivants, au mépris des ordres de sa hiérarchie. On pense aux officiers de l’armée française qui, désobéissant aux ordres de De Gaulle en 1962, ont refusé d’abandonner les harkis aux abominables massacres que les Algériens leur réservaient. Ces officiers ont en partie sauvé l’honneur de la France !
Le film est sobre, et ne sacrifie jamais au gore en montrant en gros plan les horribles mutilations subies par ces jeunes gens. Tous les acteurs sont excellents.
En bref : à voir absolument.
[Entracte 27]
Jerry Lewis est mort à Las Vegas le dimanche 20 août 2017. Il était né à Newark, dans le New Jersey, le 16 mars 1926. Il avait donc 91 ans. Son véritable nom était Jerome Joseph Levitch, et il ne l’a utilisé qu’une fois, dans son premier film officiel (voir plus loin pourquoi « officiel »), The bellboy (en français, Le dingue du palace, titre idiot comme presque tous ceux inventés pour la distribution en France). En effet, dans ce film, il jouait deux rôles, celui d’un chasseur d’hôtel ne parlant jamais sauf une phrase à la fin – un bellboy donc, appelé Stanley Belt – et celui de... Jerry Lewis, grande vedette venue passer des vacances à l’Hôtel Fontainebleau de Miami, où travaillait Stanley ; et au générique de fin, le personnage de « Jerry Lewis » est tenu par Joseph Levitch ! Il faut dire que ce pseudonyme de Lewis, il l’avait adopté parce que son père Daniel Lewis était lui-même un acteur de théâtre sous ce nom.
Jerry était doué pour tout, et il fut successivement ou en même temps acteur, chanteur, producteur de films, scénariste et réalisateur. Professeur, aussi, puisqu’il enseigna le cinéma à l’Université de Californie du Sud, et que ses cours ont été publiés sous le titre The total filmmaker (en français, Quand je fais du cinéma, en 1972). Il avait eu pour étudiants Steven Spielberg et George Lucas.
Jerry Lewis, fils unique, n’a pas eu une enfance très heureuse, car ses parents, des artistes – son père, un comique, sa mère, une pianiste qui accompagnait son mari –, s’absentaient souvent, et il trouva triste de devoir passer sa bar-mitzvah sans eux.

Néanmoins, c’est grâce à son père qu’il débuta, quoique modestement, quand, à cinq ans, il fut invité par lui à monter sur scène pour chanter. Puis, à quinze ans, ayant quitté l’école où il ne faisait rien de bon, il se lança dans un spectacle de pantomime chantée. Mais à vingt ans, il rencontra Dean Martin, chanteur de charme, doué pour l’humour, et, avec lui, forma un duo comique qui va durer une bonne dizaine d’années, aussi bien au music-hall qu’au cinéma, à la Paramount, où ils firent ensemble dix-sept films. Précisons que, contrairement à ce qui se dit habituellement des tandems d’artistes, Lewis et Martin étaient loin de se détester, comme on l’a prétendu faussement de Fred Astaire et Ginger Rogers, mais qu’ils s’appréciaient beaucoup, chacun reconnaissant à l’autre un grand talent.
Jerry, qui s’intéressait au cinéma, acquit néanmoins son indépendance en 1959, en créant sa propre maison de production. Mais comment est-il devenu réalisateur ? En remplaçant Frank Tashlin, qui devait le diriger dans Cinderfella (en français, Cendrillon aux grands pieds), et qui, malade, ne pouvait assurer sa tâche. Jerry se chargea donc de la mise en scène, non sans élégance, puisqu’il laissa Tashlin, qui était d’ailleurs un excellent réalisateur de comédies, signer le film. Restait à devenir réalisateur officiellement, et cela se passa ainsi : Cinderfella, brillant et tourné en couleurs, fit que la Paramount voulut attendre la période de Noël pour le sortir en salles. Or on était au début de l’année 1960, et elle n’avait pas de film à présenter dans l’intervalle. Jerry écrivit en hâte un scénario très simple et quasiment sans dialogues, et le réalisa... pendant ses vacances à Miami, dans l’hôtel où il était descendu. Ce fut The bellboy, et là , il signa le film, qui put sortir le 6 juillet ! Si bien que Cinderfella sortit le 22 novembre à Chicago, et en décembre à New York et Los Angeles.
Il faut dire que les ennuis de santé de Jerry ont commencé avec Cinderfella : ayant dû monter en courant et en huit secondes un escalier de 66 marches (la séquence est ci-dessous), il eut un malaise cardiaque et fut placé sous une tente à oxygène.
Il eut aussi un diabète et une fibrose pulmonaire, qu’il traîna toute sa vie. On l’opéra du cœur en 1983, et d’un cancer de la prostate en 1992. Un accident survenu le 20 mars 1965 pendant un spectacle au Sands Hotel de Las Vegas lui causa des douleurs chroniques, et le rendit esclave des antidouleurs, du Percodan, en l’occurrence. Il ne cessa d’en prendre qu’en 1978, quand on lui implanta un stimulateur qu’il pouvait télécommander.
Mais laissons de côté les ennuis de santé, et parlons plutôt de ses films.
Après Cinderfella et The bellboy, il réalisa successivement The ladies man (en français, Le tombeur de ces dames, titre qui ne convient en rien à la situation), et The errand boy, ce qui signifie « le coursier » ou « le commissionnaire » (en français, Le zinzin d’Hollywood), en noir et blanc sur un scénario de lui-même et Bill Richmond, qui s’était amusé à incarner Stan Laurel dans The bellboy.

C’est dans ce film que fut inventé le gag incomplet, que j’explique dans un autre article sur The nutty professor, LÀ. Mais son chef-d’œuvre sera justement The nutty professeur (en français, Docteur Jerry et mister Love), violemment satirique, et qui ne devait pas plaire beaucoup au public des États-Unis !
Au fait, savez-vous que Jerry imagina le plus grand décor intérieur de l’histoire du cinéma, pour The ladiesman (en français, Le tombeur de ces dames) ? Il est ci-dessous. Après le tournage, on ne démolit pas cette pièce gigantesque, et on la mit dans un musée ! C’est aussi Jerry qui eut l’idée de contrôler tous ses tournages grâce à la vidéo, en l’occurrence une caméra de télévision couplée à la caméra de cinéma, ce qui lui permettait de vérifier immédiatement si le plan était satisfaisant, sans devoir attendre le lendemain que le tirage soit fait en laboratoire.

Ses films suivants sont un peu moins bons, et, après l’échec du tournage de son film sur les camps d’extermination nazis, qu’il devait seulement interpréter mais qu’il insista pour réaliser, et qu’il termina à ses frais parce que le producteur n’avait plus d’argent, Jerry resta huit ans sans tourner. Il disait alors qu’il détestait ce que le cinéma était devenu : pornographique. Mais il se consacra constamment à des œuvres humanitaires, comme la lutte contre la distrophie musculaire, par l’intermédiaire d’un Téléthon dont il fut longtemps le présentateur. Ce pour quoi il reçut de Jack Lang la Légion d’Honneur, entre autres récompenses pour son œuvre cinématographique.
Sites associés : Yves-André Samère a son bloc-notes films racontés
Dernière mise à jour de cette page le jeudi 1er janvier 1970.