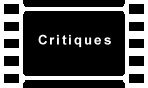- Accueil
- Classement
- Critiques par titre
- Critiques par date
- Notules
- Br1èves et spoilers
- Meilleurs et pires
- Dédaignés
- Recherches
- Vite !
- Téléciné
L’année 2015 commence très lentement, et les médiocrités abondent. Cependant, un film iranien retient l’attention, c’est Taxi Téhéran. Mais ne boudons pas notre plaisir, et disons quelques mots de Jurassic world, avant de passer à ces excellents films que son Marguerite et Le fils de Saul, et à cette curieuse et inattendue réussite, Youth.
Taxi Téhéran
Titre original : Taxi
Réalisateur : Jafar Pahani
Scénario : Jafar Pahani
Interprète : Jafar Pahani
Durée : 1 heure et 22 minutes
Sortie à Paris : mercredi 15 avril 2015
Ce film, sorti au festival de Berlin le 6 février 2015, est interdit dans son pays, l’Iran, et son réalisateur, non seulement ne peut sortir du pays, mais on lui a interdit de filmer pendant vingt ans, outre les six ans de prison qu’on lui a infligés – et qu’il n’a du reste pas faits. Taxi a donc été tourné clandestinement, en utilisant exactement la méthode utilisée par Abbas Kiarostami, dont il a été l’assistant, pour son Ten, avec toutefois quelques différences : on n’a pas employé une caméra fixe installée dans le taxi, mais trois, que le réalisateur pouvait d’ailleurs orienter différemment et à la main, selon les circonstances. L’une le filme au volant de son taxi, l’autre filme ses passagers, la troisième regarde la rue dans la direction où roule la voiture. En outre, dans certaines scènes, un petit caméscope est utilisé par sa nièce Hana, produisant des images floues et tremblotantes. Mais le principe reste identique : jamais le spectateur ne sortira de la voiture, qui parcourt la capitale de l’Iran pendant une heure et 22 minutes – le temps étant compressé par des coupures, naturellement.
Ajoutons que le film n’a évidemment pas été produit par l’Iran, puisqu’il est clandestin, mais par la propre compagnie du réalisateur, Jafar Panahi Film Productions, puis distribué par cinq firmes étrangères, de Hong Kong, des États-Unis, de Suisse et de France ; et que son titre est simplement Taxi, mot qui n’apparaît qu’à la fin et en caractères arabes. Enfin, évacuons ce qu’en dit la publicité : si Panahi fait effectivement un portrait à charge du régime politique iranien, ce portrait n’est pas « entre rires et émotion », car il ne recèle aucune trace d’émotion. En fait, sans cesse il balance entre comique, ironie et sarcasme, et le personnage de Panahi lui-même sourit constamment, conscient de faire une bonne farce, jamais virulente, au gouvernement des ayatollahs. Mais, au contraire du film de Kiarostami, il ne s’agit plus ici exclusivement de la condition féminine. Il est donc plus percutant, et plus compromettant pour son auteur.
Donc, dans le film visiblement très scénarisé, Panahi, privé de travail, gagne sa vie en faisant le taxi à Téhéran – c’est une fiction. On le voit tour à tour transporter un passager un peu irascible, partisan de la peine de mort pour quiconque vole... des roues de voitures, « juste pour envoyer un message » aux futurs éventuels voleurs (sic), un vendeur à la sauvette de DVD importés clandestinement (c’est le cas des propres films de Panahi !), un homme blessé dans un accident, deux dames âgées excentriques qui veulent arriver « avant midi » à une fontaine publique pour y rejeter un couple de poissons rouges qu’elles transportent dans un aquarium (lequel se brisera en chemin), sa jeune nièce, prétentieuse, raisonneuse et moralisatrice, qui est comme un écho du jeune Amin dans Ten, et une avocate de ses amies, qui a eu aussi des ennuis avec la justice islamique, dit pis que pendre du régime, et lui recommande de ne pas garder ses propos dans son film – il fera le contraire, on s’en doute. Le film s’achève par une scène étrange : Panahi sort de la voiture pour aller rendre son portefeuille à l’une des deux dames âgées qui a oublié cet objet dans son taxi, et deux jeunes motards viennent vandaliser son véhicule, cherchant apparemment la carte-mémoire sur laquelle il a enregistré ses prises de vue, et ne la trouvent pas. Or, puisqu’ils s’en sont pris à la caméra, il n’y a plus d’image ! Fin du film.
Les personnages chargés dans le taxi, tous joués par des amateurs, parlent beaucoup et révèlent pas mal de détails sur la vie en Iran, en n’omettant pas celui-ci, mentionné par une femme : l’Iran vient en deuxième position, après la Chine, pour le nombre d’exécutions capitales (750 en 2014, selon le « Times »). Néanmoins, le maître-mot semble être : dis et fais ce que tu veux, mais ne te fais pas prendre. Précepte que Panahi suit lui-même afin de pouvoir continuer à tourner, et il tourne beaucoup ; en général, il emploie deux équipes, l’une pour la frime, l’autre qui travaille réellement. Et si la police pointe son nez, elles échangent leurs occupations ! Cela ne va pas sans un attachement certain de la part de ses collaborateurs, encouragés qu’ils sont par le fait que Panahi est souvent récompensé dans les festivals étrangers, notamment à Cannes, à Venise, à Berlin. Et la plupart des Iraniens ont vu ces films grâce à la contrebande de DVD dont je parlais plus haut. On ne dira jamais assez les bienfaits du piratage !
Le précédent film de Panahi (avec Mojtaba Mirtahmasb, en 2011), tourné avec une caméra numérique et avec un téléphone, s’intitulait Ceci n’est pas un film, et montrait la situation d’un cinéaste privé par la justice islamique de faire son métier. Et justement, la séquence avec la jeune nièce de Panahi traite de ce que doit être, selon le gouvernement, un film « justifiable » : on ne doit pas montrer un homme et une femme ensemble, et surtout pas leur permettre de se toucher ; les personnages positifs masculins ne doivent pas porter de cravate, et doivent être « un peu barbus » ; on ne doit jamais aborder les sujets économiques ou politiques, etc. Or le film dont je parle ici s’achève par une mention sarcastique, inscrite sur un carton, mentionnant qu’il n’a pas été jugé « justifiable » par le ministère de la Culture islamique, et que, en conséquence, il ne peut pas avoir... de générique ! On ignore donc les noms des acteurs et des techniciens. Le seul nom qui apparaît, c’est celui du réalisateur. On échappe ainsi, pour une fois et c’est heureux, à ces interminables génériques de fin, qui durent habituellement au moins six minutes et font fuir le public. Il devrait y avoir davantage de censure.
En bref : à voir absolument.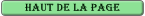
Jurassic world
Réalisateur : Colin Trevorrow
Scénario : Rick Jaffa, Amanda Silver, Colin Trevorrow et Derek Connolly, d’après une histoire de Rick Jaffa et Amanda Silver et les idĂ©es de Michael Crichton
Interprètes : Chris Pratt (Owen), Bryce Dallas Howard (tante Claire), Irrfan Khan (Masrani), Vincent D’Onofrio (Hoskins), Ty Simpkins (Gray), Nick Robinson Zach), Jake Johnson (Lowery), Omar Sy (Barry), BD Wong (docteur Henry Wu), Judy Greer (Karen), Lauren Lapkus (Vivian), Brian Tee (Hamada), Katie McGrath (Zara), Andy Buckley (Scott), Eric Edelstein (superviseur), Courtney James Clark (annonceur du Mosasaurus), Colby Boothman-Shepard (gestionnaire du jeune raptor), Jimmy Fallon (lui-mĂŞme), James DuMont (Hal Osterly), Matthew Burke (Jim Drucker), Anna Talakkottur (Erica Brand), Matty Cardarople (opĂ©rateur de la gyrosphère), Michael Papajohn (entrepreneur InGen), William Gary Smith (ranger du parc), Kelly Washington (petite amie de Zach), Isaac Keys (garde du poste de contrĂ´le), Patrick Crowley (instructeur de vol), Chad Randall (soldat), Gary Weeks (père des trois), Yvonne Angulo (Gabriella), Colin Trevorrow (M. ADN), HĂ©lène Cardona (hĂ´tesse française au centre d’innovation), Robert Deon (soldat dissident)
Durée : 2 heures et 4 minutes
Sortie à Paris : mercredi 10 juin 2015
Tout d’abord, une petite mise au point : j’ai entendu un journaliste mal renseigné, ou se contentant de peu, affirmer que Spielberg avait « imaginé Jurassic Park ». Non, c’est Michael Crichton. Cet écrivain célébrissime, mort en 2008, avait commencé des études de médecine, et il écrivait des romans pour les financer. Il a fini par ne plus faire que cela, se spécialisant dans la science-fiction et l’anticipation, et il est l’auteur, entre autres, de Jurassic Park et de sa suite Le monde perdu, tous deux portés à l’écran par Spielberg, sur un scénario de Crichton et David Koepp. Pour les deux suites à l’écran de la saga, Spielberg, tout en restant producteur, a passé le flambeau à Joe Jonhston, bon technicien, pour Jurassic Park III, puis à Colin Trevorrow, dont Jurassic world n’est que le deuxième film.
Le premier Jurassic Park, sorti en 1993, reposait sur une hypothèse qui a reçu la contradiction des milieux scientifiques : il racontait qu’on avait trouvé du sang de dinosaure dans... un moustique ayant piqué un de ces géants, au moins soixante-cinq millions d’années plus tôt, et que le moustique, pris dans une coulée d’ambre, s’était conservé absolument intact depuis cette époque. Par conséquent, l’ADN contenu dans le sang, intact aussi, pouvait être réutilisé pour donner naissance à un animal semblable à la cible du moustique. La revue « Science et Vie », notamment, avait publié un article réfutant cette possibilité, mais cela ne pouvait arrêter Hollywood ! Le film fut tourné en République Dominicaine, au Costa Rica, à Hawaii (notamment la séquence de la haie électrique), dans le désert californien de Mojave, dans le studio de la Warner, à l’Observatoire Griffith de Los Angeles, au Red Rock Canyon State de Cantil, et aux studios 12, 27 et 28 d’Universal. Bien sûr, dans le scénario, les animaux étaient recréés par des scientifiques qu’un milliardaire passionné avait engagés, mais un parc d’attraction construit sur Islar Nublar (ou Isla Nublar, île fictive du Pacifique, censée se trouver à environ 220 kilomètres à l’ouest du Costa-Rica) était victime d’un sabotage de la part du chef des services informatiques, lequel voulait vendre le précieux ADN à une entreprise concurrente, et tout se détraquait.
La suite, The lost world (en français, Le monde perdu), fut aussi réalisée par Spielberg quatre ans plus tard, car il y avait une vraie demande de la part du public. Techniquement, elle allait plus loin, et le récit se compliquait par l’intervention de trafiquants qui voulaient enlever un dinosaure pour l’exhiber sur le territoire des États-Unis. Ils y parvenaient, mais le monstre, tout comme King Kong autrefois, s’échappait et faisait pas mal de dégâts dans la ville. Néanmoins, au lieu de l’abattre comme le gorille géant car la mentalité du public a changé, on le capturait, et un bateau le ramenait sur son île.
Le troisième épisode, sorti en 2001, plus court, n’a pas été réalisé par Spielberg, et se déroulait sur une autre île, Isla Sorna, qui était déserte, très découpée par des fjords, et... tout aussi imaginaire, à 333 kilomètres à l’ouest du Costa Rica. Les scénaristes et le réalisateur ne sont plus les mêmes, mais Spielberg et sa collaboratrice Kathlyn Kennedy sont toujours co-producteurs. On a encore tourné à Hawaii, mais aussi dans le Nevada, dans l’Utah, et au parc Orlando, en Floride. Davantage de studios ont été utilisés chez Universal, les 1, 12, 18, 27, 28, 29 et 44. Au centre de l’histoire, un jeune garçon très débrouillard, disparu après un accident d’avion, et ses parents divorcés qui le recherchent, et vont évidemment se remettre ensemble à la fin de l’histoire – culte de la famille oblige.
L’épisode 4 dont on parle ici, tourné pour moitié en extérieurs à Hawaï et pour l’autre moitié dans les studios de la NASA construits à la Nouvelle-Orléans, comporte une innovation : le nouveau parc a été peuplé d’animaux n’ayant jamais existé ! Les travaux sur l’ADN ont tant progressé, qu’il est possible à présent de synthétiser un ADN totalement inédit (on dit que c’est possible, et l’actualité nous a offert cet épisode grotesque d’un mouton dont l’ADN avait reçu celui... d’une méduse !), et de créer des animaux dotés d’une férocité sur mesure, afin de créer chez les visiteurs des sensations plus fortes que celles procurées par une simple visite ! On voit d’ici l’esprit du commerce qui régit tout aux États-Unis... Et, bien entendu, le plus terrible des nouveaux monstres s’échappe, sème la terreur, et on doit évacuer l’île de ses touristes. Ce film est bien plus spectaculaire que les trois précédents, et l’une des séquences de panique rappelle Les oiseaux d’Hitchcock, lorsque des nuées de dinosaures volants s’en prennent à tous les humains.
J’avoue que, des quatre films, je préfère... le premier, parce que les personnages y étaient plus intéressants, notamment les deux enfants, un jeune garçon très ouvert et féru de science, joué par Joseph Mazzello (devenu un excellent acteur) et sa sœur aînée, très calée en informatique et qui va réussir à réparer in extremis le gigantesque bug ayant mis en panne la totalité du parc. Et le personnage de l’archéologue joué par Sam Neill connaît une évolution mentale qui le rend sympathique au public, puisque, au début, il déteste tous les enfants et se montre très agacé par l’adoration dont il est l’objet de la part du garçon, avant de succomber à leur charme et de les prendre en affection. On pense à Spielberg lui-même, qui a souvent mis des enfants dans ses films, et les dirige admirablement (souvenez-vous de Christian Bale, qui a débuté à douze ans dans Empire du Soleil, et qui est devenu une vedette mondiale). Or, dans Jurassic world, les deux garçons se révèlent d’une médiocrité abyssale, l’aîné ne n’intéressant à rien sinon aux filles, et le cadet étant dépourvu du moindre intérêt. Le spectateur doit donc se contenter des séquences purement visuelles, très réussies mais sans grande profondeur.
Bref, le spectateur en a plein la vue, néanmoins l’intelligence et la sensibilité ont été laissées de côté. Mais tout le monde n’est pas Spielberg qui, tout décrié qu’il est par les snobs, n’en a pas moins une vision de l’Humanité.
En bref : à voir.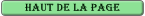
Marguerite
Réalisateur : Xavier Giannoli
Scénario : Xavier Giannoli et Marcia Romano
Interprètes : Catherine Frot (Marguerite Dumont), AndrĂ© Marcon (Georges Dumont), Denis Mpunga (Madelbos), Michel Fau (Atos Pezzini), Christa ThĂ©ret (Hazel), Sylvain Dieuaide (Lucien Beaumont), Aubert Fenoy (Kyrill Von Priest), Sophia Leboutte (FĂ©licitĂ© « La Barbue »), ThĂ©o Cholbi (Diego)
Durée : 2 heures et 7 minutes
Sortie à Paris : mercredi 16 septembre 2015
Orson Welles avait-il eu connaissance, lorsqu’il a écrit le scénario de Citizen Kane, de cette femme riche, Florence Foster Jenkins, qui chantait uniquement devant un cercles d’amis intimes (un film sur elle sera réalisé par Stephen Frears), et qui chantait faux ? C’est possible, mais son Charles Foster Kane, tombé amoureux – hors mariage – d’une chanteuse sans talent, et dont un adversaire politique avait dénoncé l’adultère avec « une chanteuse », avait voulu faire sauter ces guillemets infamants, obligé sa maîtresse à se lancer dans une carrière lyrique, et... lui avait construit un opéra, où le désastre de son absence de talent s’était révélé publiquement.
La situation est un peu différente dans le film de Xavier Giannoli, puisque sa Marguerite est la seule à ne pas percevoir que sa voix est désastreuse, et que son mari, au contraire de Kane, fait tout pour la protéger en usant d’artifices afin d’empêcher qu’elle se produise en public. Et lorsque, enfn, elle chante sur une vraie scène d’opéra, les applaudissements ironiques qu’elle recueille, elles les croit authentiques ! Mais son entourage, c’est différent, car chacun a intérêt à flatter sa lubie, puisqu’elle est aussi généreuse que riche.
Néanmoins, Marguerite est si sincère, si passionnée de musique, si émouvante, qu’elle retourne malgré eux les profiteurs, comme ce journaliste qui avait écrit sur elle un article moqueur et faussement élogieux, mais qui finit par devenir l’un de ses amis les plus protecteurs. Et lorsqu’elle engage à prix d’or un maître de musique escroc, lui non plus n’osera pas lui dire la vérité, sinon celle-ci : « Vous n’êtes pas une soprano, vous êtes... une mezzo ! ».
L’épilogue n’en sera pas moins tragique, puisqu’un médecin prend l’initiative d’enregistrer la voix de Marguerite sur un disque et de le lui faire écouter : saisie, Marguerite est foudroyée, et elle meurt subitement, ce qui rappelle encore Orson Welles et son Falstaff qui, lorsque le prince qui avait partagé ses frasques de jeunesse devient roi et refuse de le revoir, rentre chez lui, se met au lit et meurt.
Le film pourrait être comique, mais il ne l’est guère, et jamais Marguerite n’est ridiculisée, en dépit de ses interprétations atroces (elle commence et finit par un air diabolique pour une chanteuse, celui de la Reine de la Nuit dans La flûte enchantée de Mozart). Là , Catherine Frot est magistrale. Et le scénario, très travaillé et sans la moindre faute, est à la hauteur de l’interprète. En fait, c’est l’entourage qui est ridicule, avec son cortège de parasites et d’hypocrites. Décidément, les années 1920 ressemblent beaucoup à ce que nous voyons un siècle plus tard.
En bref : à voir absolument.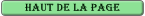
Youth
Réalisateur : Paolo Sorrentino
Titre original : La giovinezza
Scénario : Paolo Sorrentino
Interprètes : Michael Caine (Fred Ballinger), Harvey Keitel (Mick Boyle), Rachel Weisz (Lena Ballinger), Paul Dano (Jimmy Tree), Jane Fonda (Brenda Morel), Mark Kozelek (lui-mĂŞme), Robert Seethaler (Luca Moroder), Alex Macqueen (l’émissaire de la Reine), Luna Zimic Mijovic (jeune masseuse), Tom Lipinski (scĂ©nariste amoureux), Chloe Pirrie (fille scĂ©nariste), Alex Beckett (scĂ©nariste intellectuel), Nate Dern (scĂ©nariste drĂ´le), Mark Gessner (scĂ©nariste timide), Paloma Faith (elle-mĂŞme), Ed Stoppard (Julian), Sonia Gessner (Melanie), Madalina Diana Ghenea (Miss Univers), Sumi Jo (elle-mĂŞme), Leoni Amandin (Victor Victoria), Jozef Aoki, Paul Blackwell, Pamela Betsy Cooper, Shina Shihoko Nagai, Janette Sharpe (public au théâtre), Ian Keir Attard (assistant 1), Richard Banks, Jesmond Murray, Ruth Shaw (amateurs de concerts), Gabriella Belisario (escort), Melinda Bokor (jolie femme), Leo Artin Boschin (jeune violoniste), Rebecca Calder (la comtesse), Loredana Cannata (femme de Maradonna), Steve Carroll,Neve Gachev, Aaron Sequerah (invitĂ©s royaux), Eugenia Caruso (femme pieuse), Poppy Corby-Tuech (femme espionne), Beatrice Curnew (policière), Veronika Dash (Marilyn - blonde idiote), Raniero Della Peruta (père de Frances), Jason Ebelthite (enthousiaste de musique classique), Emilia Jones (Frances), Elizabeth Kinnear (Carrie dans le film d’horreur), Anabel Kutay (femme du film de science-fiction), Tatiana Luter (femme-soldat), Jay Natelle (pilote), Tony Pankhurst (employĂ© du théâtre), Roly Serrano (Diego Maradona), Josie Taylor (diva), The Retrosettes (elles-mĂŞmes), Beatrice Walker (fille en bikini)
Durée : 1 heure et 58 minutes
Sortie à Paris : mercredi 9 septembre 2015
Fred Ballinger, qui séjourne dans un hôtel en Suisse, est un ancien compositeur britannique et chef d’orchestre réputé, que la reine désirerait anoblir, à condition qu’il accepte de donner en concert à Londres une de ses œuvres, mais il refuse plusieurs fois (il finira par accepter) car il veut que seule sa femme en demeure l’interprète – or elle a perdu la raison. Dans le même hôtel se trouve Mick Boyle, réalisateur de cinéma, son ami, dont le fils Julian a épousé Lena, la fille de Ballinger, également présente, mais que son mari s’apprête à quitter pour une chanteuse de variétés. Tous deux sont presque octogénaires, néanmoins Mick a toujours des projets, et il est venu avec cinq scénaristes, car il cherche une fin pour le film qu’il prépare. Là séjourne également Jimmy Tree, acteur célèbre mais dont les admirateurs n’aiment que le film où il a naguère interprété un personnage de robot, ce qui l’agace considérablement.
Disons qu’après pas mal de péripéties, certaines comiques, d’autres dramatiques dont un suicide, l’histoire se termine sur l’acceptation de son vieillissement par l’un des deux personnages principaux – rassuré il est vrai par la confirmation que ses analyses médicales sont excellentes. Mais ce thème n’a rien d’original, et nous voyons beaucoup de films qui traitement du vieillissement accepté.
De façon un peu surprenante, ce film très anglais est dû à un Italien, Paolo Sorrentino, mais seule la séquence de fin, le concert en présence de la reine, est censée se dérouler à Londres. Auparavant, on aura vu Venise et sa Place Saint-Marc sous les eaux (allégorie ? Oui, il y a des inondations à Venise), et trois ou quatre autres images oniriques, stylisées de façon assez inattendues. Si bien que ce film à la fois drôle, émouvant et beau, mais sur une histoire plutôt banale – mêlant l’égo de l’artiste et sa crainte d’avoir perdu son inspiration –, brille essentiellement par sa mise en scène, inventive et très recherchée.
Selon moi, le scénario de Youth est supérieur à celui de La grande Bellezza, film du même auteur, auquel on a réservé un succès un peu exagéré, parce que lui aussi comportait quelques images originales, comme cette terrasse donnant sur le Colisée. Et la musique, dans tous les styles – dont un « concert » de cloches de vaches –, a été extrêmement travaillée.
À noter une apparition de Jane Fonda, qui n’a qu’une scène, véhémente en vedette de cinéma refusant le rôle que lui proposait un réalisateur que désormais elle considère comme ringard, et qui préfère à présent, non sans cynisme, un contrat de trois ans dans une série télévisée, parce que la télévision a désormais dépassé en qualité le cinéma ! Pas faux.
En bref : à voir absolument.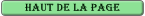
Le fils de Saul
Titre original : Saul fia
Réalisateur : László Nemes
Scénario : LászlĂł Nemes et Clara Royer
Interprètes : GĂ©za Röhrig (Saul), Levente Molnár (Abraham), Urs Rechn (l’Oberkapo Biederman), Todd Charmont (l’homme barbu), Jerzy Walczak (le rabbin dans le Sonderkommando), Sándor ZsĂłtĂ©r (le docteur), Marcin Czarnik (Feigenbaum), Amitai Kedar (Hirsch), Attila Fritz (Yankl), Kamil Dobrowolski (Mietek), Uwe Lauer (Voss), Christian Harting (l’OberscharfĂĽhrer Busch), Juli Jakab (Ella), Mendy Cahan (membre du Sonderkommando), Eszter CsĂ©pai (jeune fille dans le baraquement des femmes), Rozi SzĂ©kely (Mandel)
Durée : 1 heure et 47 minutes
Sortie à Paris : mercredi 4 novembre 2015
La fin de la Deuxième guerre mondiale approche, et nous sommes dans le camp d’extermination d’Auschwitz II ou Auschwitz-Birkenau, dans lequel certains prisonniers juifs sont obligés de nettoyer les chambres à gaz et d’enfourner les corps dans des fours, puis d’évacuer les cendres. Travail abominable, où Saul (prononcer « chaule ») est employé, et au cours duquel il croit reconnaître son fils dans un petit garçon qui, pendant quelques minutes, a survécu aux gaz asphyxiants mais est mort très vite, et doit être autopsié, afin de déterminer pourquoi il n’est pas mort immédiatement. Saul supplie alors le médecin qui doit pratiquer l’autopsie, et qui accepte de cacher le corps, afin que le père puisse le récupérer et lui donner une sépulture selon les rites juifs. Il lui faut aussi trouver un rabbin.
Saul parvient à franchir ces étapes, à la faveur d’une révolte des prisonniers, et à sortir du camp, où il s’apprête à enterrer son fils au bord d’un fleuve, sans doute la Vistule, mais les soldats nazis, à la poursuite du groupe des évadés, surgissent, et ceux-ci plongent dans le fleuve, de même que Saul, qui manque se noyer et sera sauvé par un compagnon, mais le sac contenant le corps de son fils lui a échappé, et il ne le retrouvera plus.
L’épilogue est tout aussi tragique : les fugitifs se sont cachés dans une cabane, et Saul voit dans l’embrasure un enfant de l’âge de son fils. Il lui sourit, mais l’enfant se sauve, et on comprend qu’il vient de les dénoncer, car les nazis attaquent. On ne connaîtra pas la suite, on n’entendra que les coups de feu.
Le film quoique très différent du Shoah de Claude Lanzmann, qui était un documentaire composé de témoignages, et non une fiction reconstituant les évènements, est néanmoins à la même hauteur que ce film sans équivalent, et, comme lui ne tente pas d’apitoyer le spectateur ; en somme, il fait montre de la même dignité. Mais cela l’oblige à une certaine forme de réalisation, qui a déplu à une infime partie du public, et dont je parle ci-dessous.
Le parti-pris du réalisateur a été de ne montrer que ce que voit son personnage, Saul, afin de faire du spectateur un témoin. Cela impliquait de le faire figurer dans toutes les scènes et de le suivre partout, dans tout ce qu’il ferait. Autrement dit, de le filmer en caméra portée, procédé irritant lorsque la conséquence en est que la caméra filme tout ce qui l’environne, et que le cadreur gesticule dans tous les azimuts pour ne rien laisser perdre. Ce qui est la négation même de la mise en scène et du montage, lesquels consistent à montrer ce qui important et possède un sens ; pas à montrer les détails inutiles comme le contenu d’un réfrigérateur lorsqu’un personnage en ouvre la porte, ou la main d’un autre composant un numéro de téléphone.
Or, ici, pas de gesticulations du cadreur, pas de captation de détails superflus, mais au contraire une concentration sur le visage de Saul, tout ce qui l’entoure étant perçu en arrière-plan, souvent dans le flou, et rapidement soustrait au regard de l’objectif, comme les images de cadavres que l’on traîne pour les emporter ailleurs. Aucun détail horrible, pas la moindre trace de gore, une pudeur scrupuleuse. Et l’on comprend que Claude Lanzmann loue le film et admet qu’il n’y avait pas d’autre façon de procéder.
En bref : à voir absolument.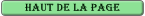
Sites associés : Yves-André Samère a son bloc-notes films racontés
Dernière mise à jour de cette page le jeudi 1er janvier 1970.